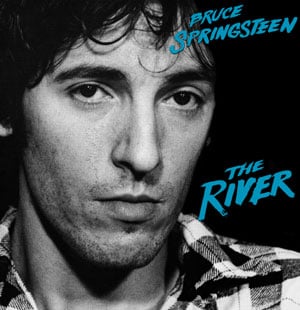Musique : Bruce Springsteen
Publié : Lundi 02 Mars 2009 04:33
BRUCE SPRINGSTEEN
Par Christophe
Born to run
Date de parution : 25 août 1975
Meilleure position dans les charts : N°3
Thunder Road
Tenth Avenue Freeze-out
Night
Backstreets
Born to Run
She's the One
Meeting Across the River
Jungeland

Ici, beaucoup de gens ne jouissent plus à se balader dans la nuit dans Paris. L'angoisse les retient, et les rues n'offrent plus qu'une peur sans plaisir. Vieille ville qui pue, sa gloire dans son dos, bien morte. New York, elle, mérite ses sueurs et ses coups durs. Lou Reed l'a dit toute sa vie, Dylan aussi, qui rôde là-bas comme un gamin gourmand. Et cet été, New York a trouvé d'autres voix pour bramer sa splendeur de putréfaction et d'extase. On entendra bientôt les Ramones, Television et Patti Smith. Mais surtout, on a déjà l'énorme cri de Bruce Springsteen. Another NYC freak. Juste un de ceux qui errent la nuit dans la cité pour le fameux plaisir, un creux au ventre. Creem cite un passage de Kerouac décrivant Dean Moriarty, le héros fou de "Sur la route", pour situer le personnage de Springsteen. Je penserais plutôt au Ringolevio d'Emmett Crogan, à cause des traits si marqués, du très beau sourire et de la dégaine dure. Le genre de type qui connaît son chemin, pour un casse chez les riches, pour une sacrée défonce ou pour l'amour.
Springsteen a déjà fait deux disques, deux épaisses et juteuses confessions, entre la rage de Bob Seger et l'élan poétique de Tim Buckley. Born to run ne garde que les mots essentiels et cet éclat de fureur prodigieux qu'est la voix. Un peu celle de Before the flood, mais un tout autre timbre, plus naturellement large et profond. Dylan et Springsteen n'ont en commun que le tempérament, et la sensualité. Et Bruce non plus, n'a pas choisi le rock'n'roll : c'est l'unique vague, et puissante encore pour longtemps. Born to run est un formidable gâteau de la même vieille pâte, et un cadeau inespéré. Pas seulement pour son rock'n'roll, mais surtout grâce au bonhomme qu'il révèle. Et tout là-bas, les yeux se sont ouverts comme des soucoupes, et les stylos flétris ont glissé des oreilles blasées de la presse.
Thunder road s'ouvre à l'harmonica, puis les premiers jets de voix vous saisissent tout le corps. Comme si Dylan avait un fils qui chante plus hard que lui, mais pas Dylan, il n'y aura jamais d'autre Dylan, le vieux Bob suffit bien, et Springsteen est bien là, râlant mots, syllabes et phrases pour soudain se mettre à gueuler vers le ciel noir.
Le groupe sonne impitoyablement gras, mais les parties d'orgue ou de piano alternent avec subtilité, et les magnifiques chorus du saxo noir savent jaillir comme si vraiment, à cet instant précis, on avait besoin de la splendeur hautaine d'un saxophone.
Tous les morceaux sont du même sang, un sang de loup. Parfois tassés et directs, comme Born to run et Night, parfois grandioses et terribles (Backstreets et Jungleland), ballades motorisées comme jamais Mott ne sut en rouler. Et Springsteen grommelle ses fantasmes (Meeting across the river) ou ses passions (She's the one, extraordinaire chanson où tous les gestes sont des tortures) à la manière effrayante d'un funambule trop ivre et donc un peu trop romantique, mais tellement fort qu'il vous écrase tout à coup d'un riff monstrueux et vous avale de son sourire. L'album a dû être enregistré dans un garage. Oui, c'est bien le son qu'il faut à cette musique, un grand garage et le boucan du diable. Et trois micros sur scène, rien que pour lui, tant il court, et tant sa gueulante est superbe. Alors, tous ceux qui grimpent aux murs quand la nuit vient, soyez heureux, Bruce Springsteen est pour vous. Le reste n'est que poussière de merde.
(François Ducray - Rock & Folk N°106 - 11/1975)
Lors de sa tournée Tunnel of love Bruce Springsteen a présenté Born to run comme son titre préféré. "Je ne sais pas si c'est ma meilleure chanson", disait-il, "mais je suis surpris de voir tout ce que je connaissais de ma propre vie à l'époque". La chanson qui libéra Springsteen de son image de néo-Dylan faillit ne jamais sortir. Il travailla à l'enregistrement de Born to run pendant cinq laborieux mois, mais il fallut aussi un pur coup de chance et un étudiant pour changer le cours de sa carrière.
En 1974, Springsteen était enlisé dans un statut de héros confidentiel et ses relations avec la Columbia étaient tendues. Après la vente médiocre de son deuxième album, The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle, son imprésario, Mike Appel, avait fait livrer aux cadres de la maison de disques des sacs de charbon pour Noël ; bientôt, les gens du label suggérèrent qu'il fasse son disque suivant avec des musiciens de studio au lieu du E Street Band. C'était trop radical, mais des changements étaient nécessaires. Louant le deuxième album, le critique Jon Landau écrivait que le batteur, Vini Lopez, était le "constant point faible de l'album" et jugeait l'enregistrement "un peu maigre ou forçant sur les aigus". Springsteen semblait d'accord : avant le troisième album, Lopez a été remplacé par Ernest "Boom" Carter et le principal fut, lors des séances du premier titre de l'album, de rendre le son aussi large que possible. Springsteen a dit un jour que son but était de chanter comme Roy Orbison avec des textes dans l'esprit dylanien et un son proche de celui des productions du Phil Spector du début des années 60.
La chanson, écrite par Springsteen, alors âgé de 24 ans, incarne parfaitement sa vision du fragile rêve américain : c'est l'appel émotif et imagé à une fille d'un "cavalier solitaire et effrayé" qui essaye de se sortir du "piège mortel" d'une petite ville et conduit sa "machine à suicide" sur des autoroutes "embouteillées de héros cassés". Springsteen, le E Street Band - Carter, Garry Tallent, Danny Federici, Clarence Clemons et David Sancious - et le coproducteur Appel retournèrent au 914, un studio de Blauvelt, dans l'Etat de New York, où les deux premiers albums avaient été enregistrés.
Le chanteur savait, selon Appel, que "cette chanson allait donner le ton à tout un album et à toute sa carrière". Ce fait pesa lourdement sur la période d'enregistrement du titre, qui dura le temps habituellement requis pour celui d'un album. "Ce n'était pas seulement l'enregistrement d'une chanson", dit Louis Lahav, ingénieur du son pendant les sessions. "C'était cette chose en laquelle on croyait tellement fort, comme une religion". Appel avait rencontré récemment Jeff Barry, co-auteur de nombre de hits de Phil Spector, et ils avaient parlé des techniques utilisées par Spector pour obtenir son célèbre "mur de sons". Springsteen et Appel s'efforcèrent de retrouver ce son pour Born to run : garder le pied sur la pédale du piano, afin de générer un lourd bourdonnement, superposer d'innombrables pistes de guitares, de saxophones et de cordes, rajouter échos et réverbérations.
Le "Da doo ron ron" inspiré de l'ouverture de la chanson, par exemple, fut réalisé en soulignant les multiples pistes de sax baryton de Clemons, à l'aide du synthétiseur de Sancious. Un glockenspiel très spectorien est également au premier plan. "C'était un seize pistes", dit Lahav, "mais il donnait autant de possibilités qu'un 32-pistes aujourd'hui." Et d'ajouter : "pas moyen de se reposer une seconde pendant le mixage". Columbia trouva le résultat trop long pour un 45 tours, mais les pistes surchargées rendaient le morceau impossible à remixer et à monter, et le label bloqua les fonds pour le reste de l'album. Appel envoya alors des cassettes de la chanson à quelques douzaines de stations radio qui la diffusèrent avec bonheur. Ce qui ne fit qu'augmenter la fureur de Columbia.
Springsteen et le E Street Band retournèrent alors sur le circuit des universités pour payer leurs loyers ; à Brown University, le chanteur donna une interview au journal du campus, déplorant que le nouveau président de CBS, Irwin Segalstein, ne s'intéresse pas aux artistes et veuille le laisser tomber. Ce que Springsteen ne savait pas, c'est que le fils de Segalstein - un fan de Springsteen - fréquentait la Brown University ; consterné par le comportement de son père, il l'appela chez lui pour se plaindre. Segalstein à son tour appela Appel qui menaça d'autres articles accablants ; finalement, tout s'arrangea. Columbia desserra les cordons de la bourse ; Max Weinberg et Roy Bittan remplacèrent Carter et Sancious. Jon Landau arriva comme co-producteur (et devint plus tard l'imprésario de Springsteen), et les séances eurent lieu à New York. Landau essaya de remixer Born to run, mais réalisa que, tout comme un enregistrement de Spector, il ne fallait plus y toucher.
Au fil des années, la chanson a acquis un sens plus profond pour Springsteen. Il raconte volontiers qu'il a choisi de jouer Born to run en version acoustique lors de sa tournée du Tunnel Of Love, parce que, dit-il, "je voulais donner aux gens l'occasion de redécouvrir la chanson. Et à moi aussi. Avant, les gens la vivaient uniquement dans ce qu'elle a de viscéral, elle leur insufflait un sens de la liberté individuelle… Dans mon interprétation actuelle, je mets l'accent sur la responsabilité".
"Quand je l'ai écrite, c'était l'histoire d'un garçon et d'une fille qui voulaient courir et ne jamais s'arrêter ", disait Springsteen à l'un de ses publics cette année." En viellisant, j'ai réalisé combien cela me ressemblait, et à quel point je ne voulais pas que ça me ressemble !"
Comme il le fait remarquer, Born to run disait : "Je veux cela" - que ce soit la liberté individuelle, un foyer, l'amitié, l'amour ou la quête de quelque chose de mieux - quinze ans plus tard, on comprend bien plus clairement ce que sont ces choses, ce qu'elles coûtent, et leur importance. Et ça, c'est devenir adulte !"
(Rolling Stone Edition Française N°15 - 5 au 31/10/1988)
Par Christophe
Born to run
Date de parution : 25 août 1975
Meilleure position dans les charts : N°3
Thunder Road
Tenth Avenue Freeze-out
Night
Backstreets
Born to Run
She's the One
Meeting Across the River
Jungeland

Ici, beaucoup de gens ne jouissent plus à se balader dans la nuit dans Paris. L'angoisse les retient, et les rues n'offrent plus qu'une peur sans plaisir. Vieille ville qui pue, sa gloire dans son dos, bien morte. New York, elle, mérite ses sueurs et ses coups durs. Lou Reed l'a dit toute sa vie, Dylan aussi, qui rôde là-bas comme un gamin gourmand. Et cet été, New York a trouvé d'autres voix pour bramer sa splendeur de putréfaction et d'extase. On entendra bientôt les Ramones, Television et Patti Smith. Mais surtout, on a déjà l'énorme cri de Bruce Springsteen. Another NYC freak. Juste un de ceux qui errent la nuit dans la cité pour le fameux plaisir, un creux au ventre. Creem cite un passage de Kerouac décrivant Dean Moriarty, le héros fou de "Sur la route", pour situer le personnage de Springsteen. Je penserais plutôt au Ringolevio d'Emmett Crogan, à cause des traits si marqués, du très beau sourire et de la dégaine dure. Le genre de type qui connaît son chemin, pour un casse chez les riches, pour une sacrée défonce ou pour l'amour.
Springsteen a déjà fait deux disques, deux épaisses et juteuses confessions, entre la rage de Bob Seger et l'élan poétique de Tim Buckley. Born to run ne garde que les mots essentiels et cet éclat de fureur prodigieux qu'est la voix. Un peu celle de Before the flood, mais un tout autre timbre, plus naturellement large et profond. Dylan et Springsteen n'ont en commun que le tempérament, et la sensualité. Et Bruce non plus, n'a pas choisi le rock'n'roll : c'est l'unique vague, et puissante encore pour longtemps. Born to run est un formidable gâteau de la même vieille pâte, et un cadeau inespéré. Pas seulement pour son rock'n'roll, mais surtout grâce au bonhomme qu'il révèle. Et tout là-bas, les yeux se sont ouverts comme des soucoupes, et les stylos flétris ont glissé des oreilles blasées de la presse.
Thunder road s'ouvre à l'harmonica, puis les premiers jets de voix vous saisissent tout le corps. Comme si Dylan avait un fils qui chante plus hard que lui, mais pas Dylan, il n'y aura jamais d'autre Dylan, le vieux Bob suffit bien, et Springsteen est bien là, râlant mots, syllabes et phrases pour soudain se mettre à gueuler vers le ciel noir.
Le groupe sonne impitoyablement gras, mais les parties d'orgue ou de piano alternent avec subtilité, et les magnifiques chorus du saxo noir savent jaillir comme si vraiment, à cet instant précis, on avait besoin de la splendeur hautaine d'un saxophone.
Tous les morceaux sont du même sang, un sang de loup. Parfois tassés et directs, comme Born to run et Night, parfois grandioses et terribles (Backstreets et Jungleland), ballades motorisées comme jamais Mott ne sut en rouler. Et Springsteen grommelle ses fantasmes (Meeting across the river) ou ses passions (She's the one, extraordinaire chanson où tous les gestes sont des tortures) à la manière effrayante d'un funambule trop ivre et donc un peu trop romantique, mais tellement fort qu'il vous écrase tout à coup d'un riff monstrueux et vous avale de son sourire. L'album a dû être enregistré dans un garage. Oui, c'est bien le son qu'il faut à cette musique, un grand garage et le boucan du diable. Et trois micros sur scène, rien que pour lui, tant il court, et tant sa gueulante est superbe. Alors, tous ceux qui grimpent aux murs quand la nuit vient, soyez heureux, Bruce Springsteen est pour vous. Le reste n'est que poussière de merde.
(François Ducray - Rock & Folk N°106 - 11/1975)
Lors de sa tournée Tunnel of love Bruce Springsteen a présenté Born to run comme son titre préféré. "Je ne sais pas si c'est ma meilleure chanson", disait-il, "mais je suis surpris de voir tout ce que je connaissais de ma propre vie à l'époque". La chanson qui libéra Springsteen de son image de néo-Dylan faillit ne jamais sortir. Il travailla à l'enregistrement de Born to run pendant cinq laborieux mois, mais il fallut aussi un pur coup de chance et un étudiant pour changer le cours de sa carrière.
En 1974, Springsteen était enlisé dans un statut de héros confidentiel et ses relations avec la Columbia étaient tendues. Après la vente médiocre de son deuxième album, The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle, son imprésario, Mike Appel, avait fait livrer aux cadres de la maison de disques des sacs de charbon pour Noël ; bientôt, les gens du label suggérèrent qu'il fasse son disque suivant avec des musiciens de studio au lieu du E Street Band. C'était trop radical, mais des changements étaient nécessaires. Louant le deuxième album, le critique Jon Landau écrivait que le batteur, Vini Lopez, était le "constant point faible de l'album" et jugeait l'enregistrement "un peu maigre ou forçant sur les aigus". Springsteen semblait d'accord : avant le troisième album, Lopez a été remplacé par Ernest "Boom" Carter et le principal fut, lors des séances du premier titre de l'album, de rendre le son aussi large que possible. Springsteen a dit un jour que son but était de chanter comme Roy Orbison avec des textes dans l'esprit dylanien et un son proche de celui des productions du Phil Spector du début des années 60.
La chanson, écrite par Springsteen, alors âgé de 24 ans, incarne parfaitement sa vision du fragile rêve américain : c'est l'appel émotif et imagé à une fille d'un "cavalier solitaire et effrayé" qui essaye de se sortir du "piège mortel" d'une petite ville et conduit sa "machine à suicide" sur des autoroutes "embouteillées de héros cassés". Springsteen, le E Street Band - Carter, Garry Tallent, Danny Federici, Clarence Clemons et David Sancious - et le coproducteur Appel retournèrent au 914, un studio de Blauvelt, dans l'Etat de New York, où les deux premiers albums avaient été enregistrés.
Le chanteur savait, selon Appel, que "cette chanson allait donner le ton à tout un album et à toute sa carrière". Ce fait pesa lourdement sur la période d'enregistrement du titre, qui dura le temps habituellement requis pour celui d'un album. "Ce n'était pas seulement l'enregistrement d'une chanson", dit Louis Lahav, ingénieur du son pendant les sessions. "C'était cette chose en laquelle on croyait tellement fort, comme une religion". Appel avait rencontré récemment Jeff Barry, co-auteur de nombre de hits de Phil Spector, et ils avaient parlé des techniques utilisées par Spector pour obtenir son célèbre "mur de sons". Springsteen et Appel s'efforcèrent de retrouver ce son pour Born to run : garder le pied sur la pédale du piano, afin de générer un lourd bourdonnement, superposer d'innombrables pistes de guitares, de saxophones et de cordes, rajouter échos et réverbérations.
Le "Da doo ron ron" inspiré de l'ouverture de la chanson, par exemple, fut réalisé en soulignant les multiples pistes de sax baryton de Clemons, à l'aide du synthétiseur de Sancious. Un glockenspiel très spectorien est également au premier plan. "C'était un seize pistes", dit Lahav, "mais il donnait autant de possibilités qu'un 32-pistes aujourd'hui." Et d'ajouter : "pas moyen de se reposer une seconde pendant le mixage". Columbia trouva le résultat trop long pour un 45 tours, mais les pistes surchargées rendaient le morceau impossible à remixer et à monter, et le label bloqua les fonds pour le reste de l'album. Appel envoya alors des cassettes de la chanson à quelques douzaines de stations radio qui la diffusèrent avec bonheur. Ce qui ne fit qu'augmenter la fureur de Columbia.
Springsteen et le E Street Band retournèrent alors sur le circuit des universités pour payer leurs loyers ; à Brown University, le chanteur donna une interview au journal du campus, déplorant que le nouveau président de CBS, Irwin Segalstein, ne s'intéresse pas aux artistes et veuille le laisser tomber. Ce que Springsteen ne savait pas, c'est que le fils de Segalstein - un fan de Springsteen - fréquentait la Brown University ; consterné par le comportement de son père, il l'appela chez lui pour se plaindre. Segalstein à son tour appela Appel qui menaça d'autres articles accablants ; finalement, tout s'arrangea. Columbia desserra les cordons de la bourse ; Max Weinberg et Roy Bittan remplacèrent Carter et Sancious. Jon Landau arriva comme co-producteur (et devint plus tard l'imprésario de Springsteen), et les séances eurent lieu à New York. Landau essaya de remixer Born to run, mais réalisa que, tout comme un enregistrement de Spector, il ne fallait plus y toucher.
Au fil des années, la chanson a acquis un sens plus profond pour Springsteen. Il raconte volontiers qu'il a choisi de jouer Born to run en version acoustique lors de sa tournée du Tunnel Of Love, parce que, dit-il, "je voulais donner aux gens l'occasion de redécouvrir la chanson. Et à moi aussi. Avant, les gens la vivaient uniquement dans ce qu'elle a de viscéral, elle leur insufflait un sens de la liberté individuelle… Dans mon interprétation actuelle, je mets l'accent sur la responsabilité".
"Quand je l'ai écrite, c'était l'histoire d'un garçon et d'une fille qui voulaient courir et ne jamais s'arrêter ", disait Springsteen à l'un de ses publics cette année." En viellisant, j'ai réalisé combien cela me ressemblait, et à quel point je ne voulais pas que ça me ressemble !"
Comme il le fait remarquer, Born to run disait : "Je veux cela" - que ce soit la liberté individuelle, un foyer, l'amitié, l'amour ou la quête de quelque chose de mieux - quinze ans plus tard, on comprend bien plus clairement ce que sont ces choses, ce qu'elles coûtent, et leur importance. Et ça, c'est devenir adulte !"
(Rolling Stone Edition Française N°15 - 5 au 31/10/1988)